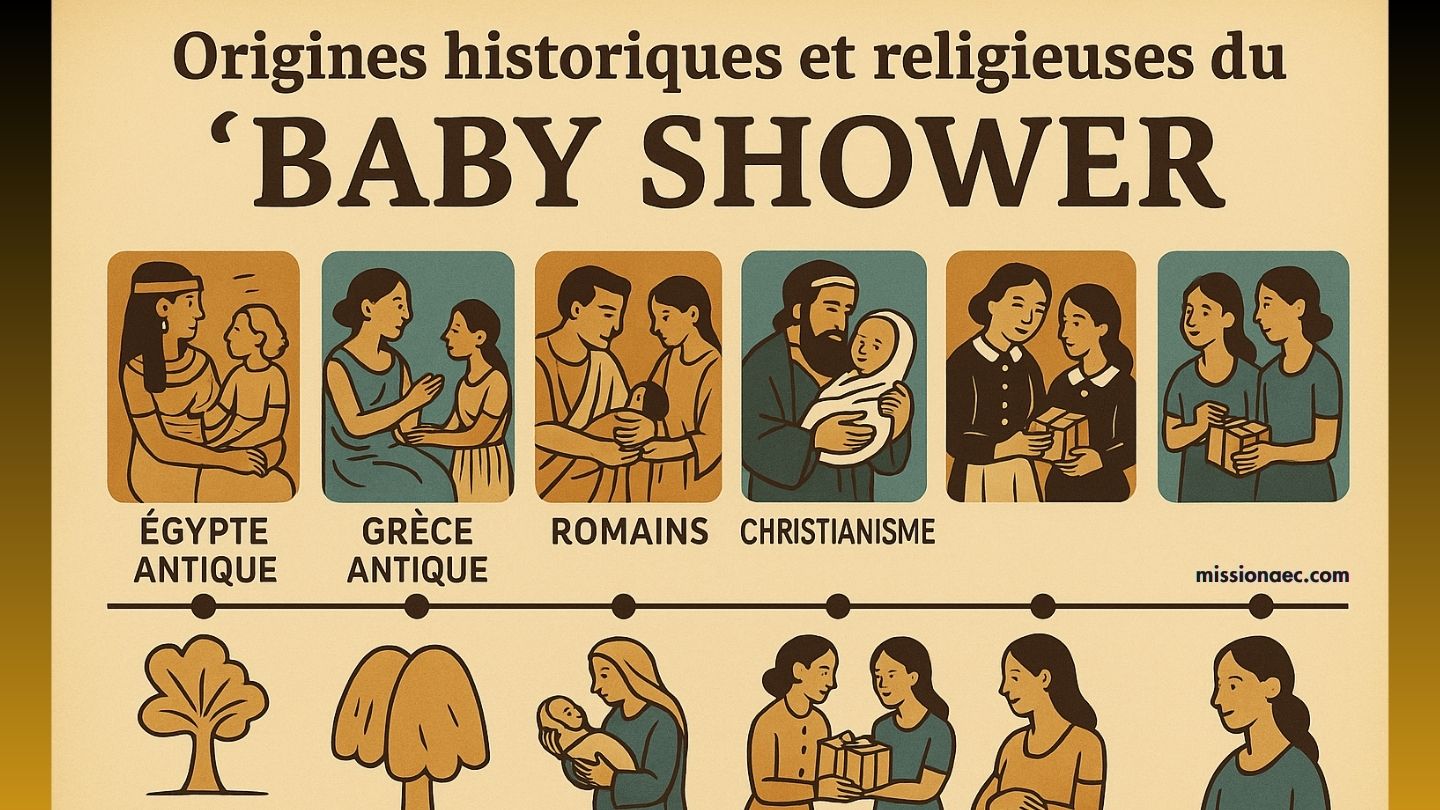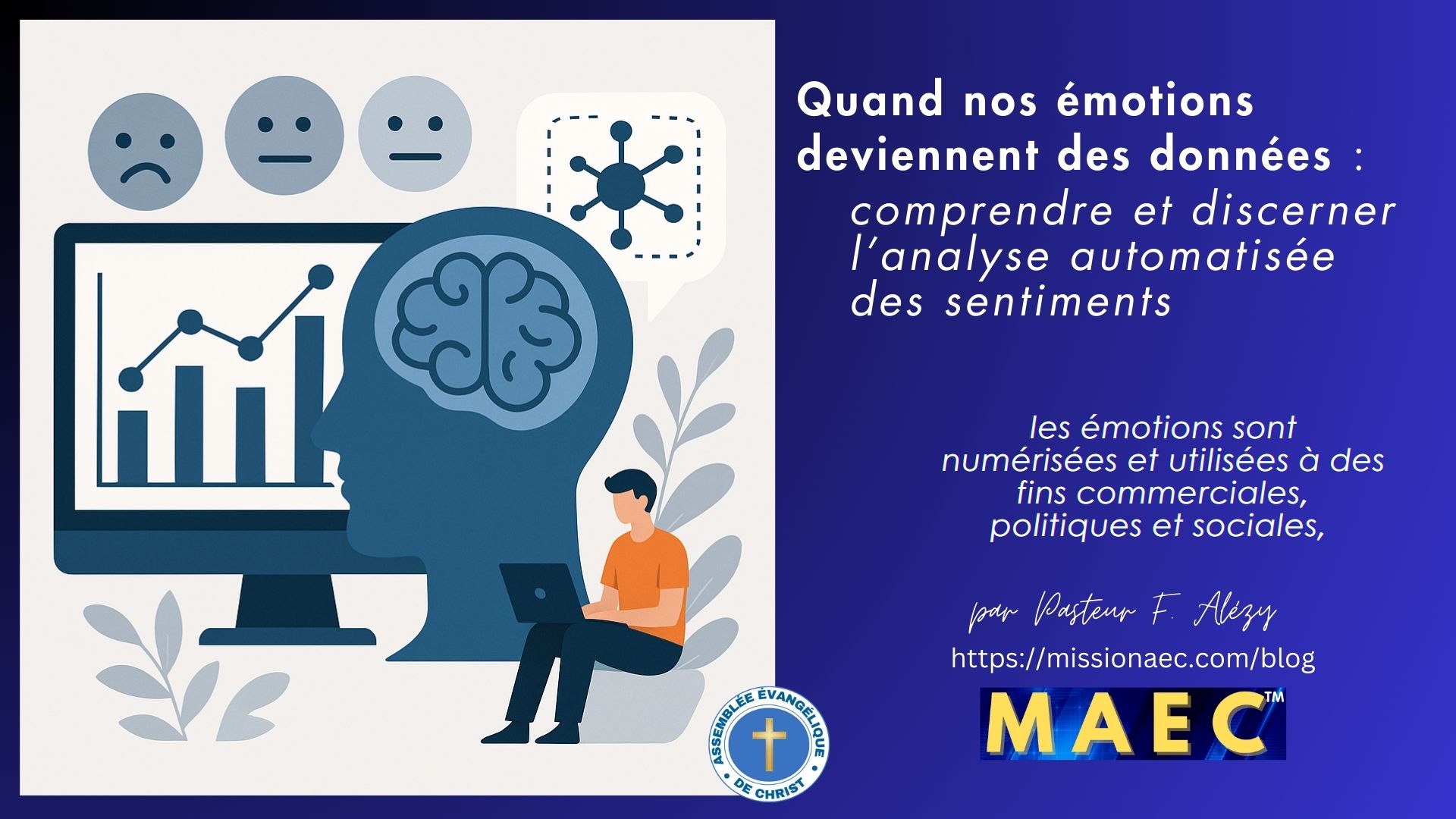Plagiat version 2.0 à l’ère de l’intelligence artificielle : faut-il s’inquiéter ?
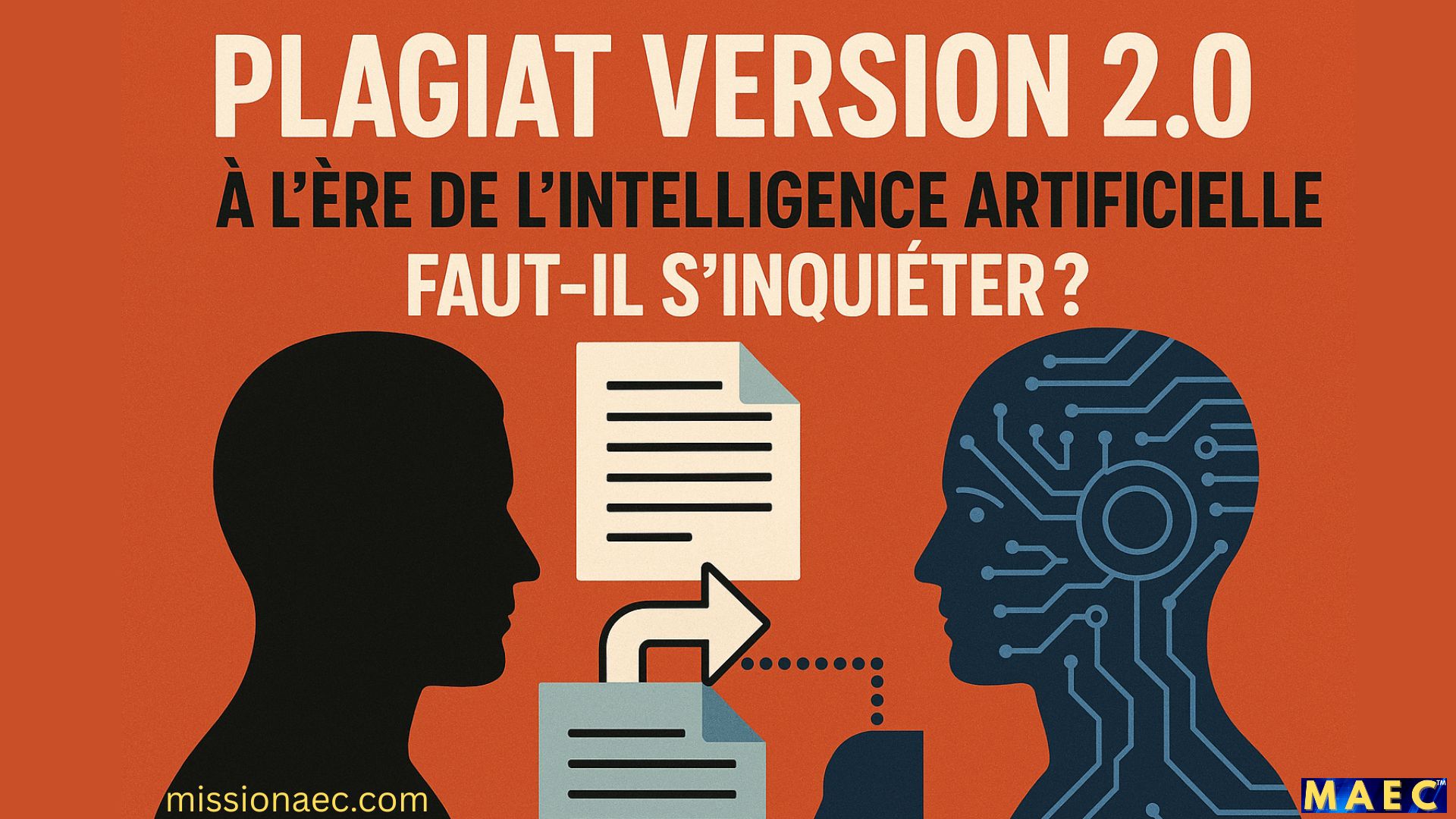 Sep 29, 2025
Sep 29, 2025
description de l'évenement
1. Introduction
Avec l’émergence rapide et massive des technologies d’intelligence artificielle (IA), notamment les générateurs de texte tels que ChatGPT, Claude et d’autres, la question du plagiat entre dans une nouvelle ère. Ce que l’on pourrait qualifier de « plagiat version 2.0 » ne se limite plus au simple copier-coller de contenu, mais soulève désormais des enjeux plus complexes liés à l’automatisation de la création de contenu, à l’originalité intellectuelle, et à la traçabilité des sources.
Cette problématique dépasse les frontières du monde académique. Elle s’étend désormais aux sphères professionnelles, ecclésiales, éducatives et culturelles, impactant de manière transversale les pratiques discursives, pédagogiques et spirituelles de notre temps.
Ce dossier vise à explorer la nature du plagiat dans le contexte de l’IA générative, à analyser les risques et les implications éthiques, et à proposer des pistes de réflexion adaptées à l’Église évangélique, à la famille et à la société d’aujourd’hui.
Particulièrement, dans le contexte d’Haïti, cette problématique prend une dimension critique. En effet, compte tenu des faiblesses structurelles du système éducatif haïtien, marquées par des carences en ressources pédagogiques, un manque de formation continue des enseignants, et une culture académique parfois peu exigeante en matière de rigueur intellectuelle, la prolifération des outils d’IA générative pourrait aggraver les inégalités et accentuer la dépendance cognitive de la jeunesse.
Dans un monde où la compétitivité internationale repose de plus en plus sur l’innovation, la pensée critique et l’authenticité intellectuelle, comment pouvons-nous accompagner les jeunes haïtiens face à ce grand défi du siècle ?
Un appel général s’impose : celui de soulever une réflexion critique et de mettre en place une véritable pastorale de l’éducation, à la fois lucide et prophétique, sur cette problématique. L’Église évangélique a ici un rôle fondamental à jouer : former, enseigner, éveiller les consciences et contribuer à une éducation chrétienne ancrée dans l’éthique, la vérité et la dignité humaine. Car si l’intelligence artificielle peut aider, seule une conscience formée par la Parole de Dieu saura l’utiliser avec responsabilité.
1.1 Définition et évolution du plagiat
Historiquement, le plagiat désigne l’appropriation frauduleuse de l’œuvre d’autrui, sans mention de la source, afin d’en revendiquer la paternité intellectuelle. Selon l’Office de la propriété intellectuelle, il constitue une forme de contrefaçon morale.
Avec le numérique, puis l’IA, la nature du plagiat s’est transformée. Aujourd’hui, le contenu peut être généré automatiquement, remixé ou reformulé, rendant les limites entre création originale, paraphrase assistée, et copie difficilement discernables.
1.2 L’apport et les dérives de l’IA générative
Les IA génératives comme ChatGPT permettent de produire des textes cohérents, argumentés et stylistiquement soignés en quelques secondes. Si cela peut servir de support à la réflexion, la tentation est grande de s’en remettre entièrement à l’outil, en le présentant comme une production personnelle.
Le risque majeur est donc double :
- D’une part, la disparition progressive de l’effort critique et de la pensée personnelle.
- D’autre part, une inflation de contenus génériques sans véritable ancrage éthique, théologique ou académique.
2. Enjeux et implications du plagiat à l’ère de l’IA
2.1 Enjeux académiques et éducatifs
Les établissements d’enseignement sont confrontés à une crise d’authenticité. Des étudiants peuvent présenter des dissertations générées par IA sans contribution personnelle, brouillant les critères d’évaluation. Certains chercheurs utilisent même l’IA pour générer des articles scientifiques entiers, ce qui pose la question de la propriété intellectuelle des idées.
Des universités mettent en place des politiques spécifiques pour encadrer l’usage de l’IA, imposant la transparence, l’attribution des sources et l’interdiction d’en faire un outil de substitution totale à la pensée critique.
2.2 Impacts dans la sphère ecclésiale
Dans le cadre de l’Église évangélique, le recours à l’IA peut être utile pour l’étude biblique ou la préparation de prédications. Toutefois, une dérive possible est la tentation de présenter une méditation ou une homélie générée par IA comme le fruit d’une étude spirituelle personnelle.
Ce phénomène pourrait :
- Miner l’intégrité du ministère pastoral.
- Éroder la confiance des fidèles dans la parole prêchée.
- Créer une dépendance technologique au détriment de la prière, de l’inspiration biblique, et du discernement personnel.
Il devient donc impératif de rappeler que la prédication ne peut être « sous-traitée », même partiellement, à un outil technologique, aussi sophistiqué soit-il.
2.3 Répercussions sociales et familiales
Sur le plan sociétal, l’usage de l’IA dans la production de contenus se banalise, y compris dans les écoles, les universités et le monde du travail. Pour les familles chrétiennes et les éducateurs, un nouveau défi se pose : comment inculquer la valeur du travail personnel, de la vérité et de l’honnêteté dans un monde où tout peut être « généré » sans effort ?
Ce défi est d’ordre éthique et pédagogique : former des consciences capables de résister à la facilité et de valoriser la construction personnelle du savoir et de la foi.
3. Perspectives bibliques et éthiques
3.1 Le plagiat et la Bible : une question de vérité
La Bible insiste sur l’intégrité personnelle. Le huitième commandement – « Tu ne voleras point » (Exode 20:15) – peut s’étendre au vol intellectuel. Prendre le fruit du travail d’autrui et se l’attribuer est une forme de mensonge.
L’apôtre Paul, lui-même, affirme dans 2 Corinthiens 8:21 :
« Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. »
Dans un contexte d’IA, cela implique que l’usage de ces outils doit être marqué par la transparence, la reconnaissance des sources et la quête de vérité.
3.2 La responsabilité morale à l’ère numérique
L’IA ne supprime pas la responsabilité humaine. L’utilisateur reste responsable de ce qu’il publie ou partage. Selon Galates 6:7 :
« On ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. »
Utiliser l’IA pour créer du contenu nécessite donc un discernement moral. Il ne s’agit pas de rejeter la technologie, mais de l’utiliser avec sagesse et intégrité, dans la crainte de Dieu.
3.3 Former la conscience à l’honnêteté
L’éducation chrétienne doit intégrer cette réalité : nos enfants et nos jeunes seront confrontés à des outils puissants, mais éthiquement ambivalents. Il s’agit donc de former la conscience, pas simplement d’interdire.
Proverbes 4:23 : « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. »
4. Recommandations et orientations
4.1 Pour les institutions éducatives chrétiennes
- Clarifier les politiques d’usage de l’IA.
- Encourager les travaux réflexifs et personnels.
- Former les enseignants à repérer et encadrer les dérives.
4.2 Pour les pasteurs et leaders spirituels
- Ne pas céder à la facilité technologique dans la prédication.
- Prôner une théologie incarnée et réfléchie.
- Encadrer l’usage de l’IA dans les ministères.
4.3 Pour les familles et la société
- Dialoguer sur l’usage de l’IA dans la vie quotidienne.
- Encourager l’effort personnel et l’authenticité.
- Intégrer une formation éthique dès l’enfance.
Conclusion
Le plagiat version 2.0 à l’ère de l’IA ne consiste pas simplement à copier, mais à déléguer la pensée à une machine sans en assumer la responsabilité. Il y a lieu de s’inquiéter si cette pratique devient la norme et qu’elle érode les fondements de la vérité, de l’authenticité et de l’intégrité.
Pour l’Église évangélique, la famille chrétienne, les écoles et la société, l’enjeu est de taille : redonner à la vérité, au travail personnel et à l’inspiration divine leur juste place dans une ère d’automatisation généralisée.
Bibliographie
- Exode 20:15 ; 2 Corinthiens 8:21 ; Galates 6:7 ; Proverbes 4:23
- Jean-Michel Besnier, L’Homme simplifié. Le syndrome de la touche étoile, Fayard, 2012.
- Florence Piron, Éthique de la recherche et intégrité scientifique, Presses de l’Université Laval, 2021.
- Margaret Mitchell, Plagiarism and Academic Integrity in the Digital Age, IGI Global, 2020.
- Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Seuil, 1990.
Pasteur Francener Alézy, Adm.A., M. Ing, DIC, D.Min | Expert en IA
Mission Assemblée Évangélique de Christ - Montréal
- Participez aux cultes du dimanche matin 11h30 en présentiel au 8480 rue Champ d'eau, St-Leonard (suite 212)
- Participez avec nous aux enseignements biblique le dimanche soir 19h sur youtube, Gotomeeting
- Pour devenir membre : https://missionaec.com/devenirmembre
- Dons, Dimes et Offrandes : missionaec.com/dons
- Demande de prière : https://missionaec.com/prier
Partagez ceci
tu dois être connecté pour poster un commentaire
-
L’art de la concentration : La compétence la plus rare de 202625 Dec 2025 12:00 am
-
IA Puce Électronique et Discernement selon Apocalypse 1327 Nov 2025 12:00 am
-
Le "Baby Shower" — Une célébration à revisiter à la lumière des Saintes Écritures21 Oct 2025 12:00 am
Copyright © 2024. All Right Reserved. Mission Assemblée Évangélique de Christ (MAEC) - CA